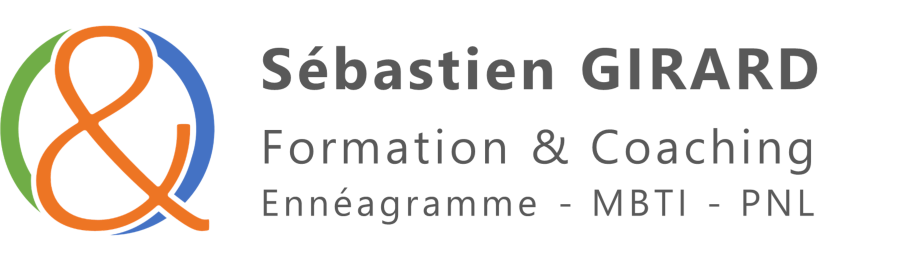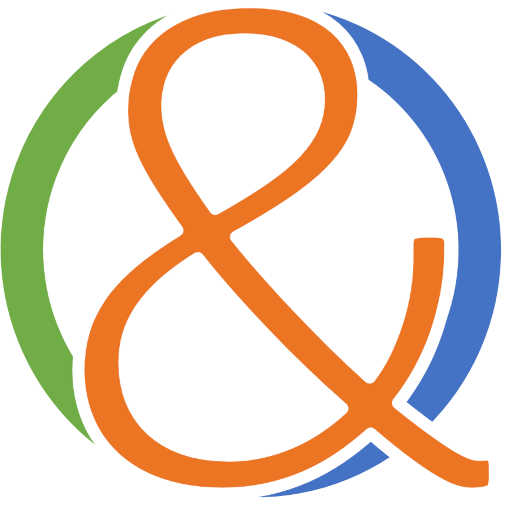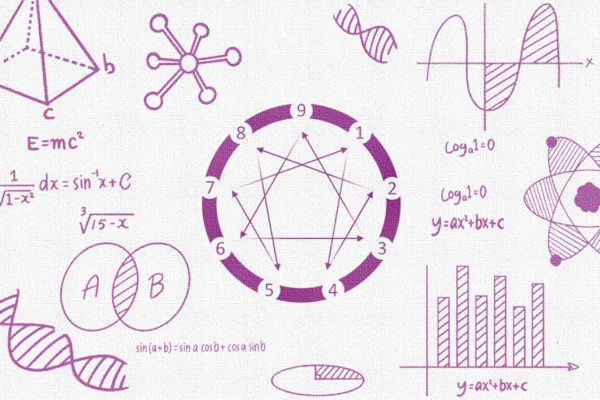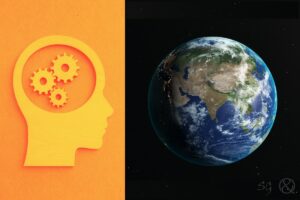Répondre à cette question demande de spécifier de quoi on parle, tant le terme « ennéagramme » peut recouvrir des réalités différentes :
■ Le modèle de l’ennéagramme, avec ses 9 profils de personnalité, a bien fait l’objet d’une validation scientifique.
■ L’approche pédagogique qui en est faite, n’est scientifique que si celui ou celle qui la propose est dans cet état d’esprit.
■ L’ennéagramme ancien, enfin, n’a aucune validation scientifique, bien qu’il ait été une intuition étonnamment juste de la personnalité humaine.
L’ennéagramme : un modèle dynamique de la personnalité
L’ennéagramme est un prisme d’observation de la personnalité, qui reconnaît 9 grandes structures de caractère, ou profils de personnalité, dont les interconnexions privilégiées se trouvent représentées par le diagramme.
Chaque profil est un ensemble qui a sa propre cohérence, entre un jeu de croyances type, de peurs et de motivations profondes héritées de la petite enfance, se traduisant par des patterns réactionnels caractéristiques à l’âge adulte.
L’ennéagramme se positionne dans le champ des réactions intérieures spontanées, instinctives, affectives et cognitives. Il s’inscrit en particulier dans le champ de nos relations interpersonnelles.
C’est enfin un modèle dynamique, qui propose une explication aux variations de réactivité observées, selon que l’on se sent en situation de stress ou de sécurité. Il décrit également avec beaucoup de justesse les évolutions possibles de la personnalité au fil du temps.
Complété par les sous-types, l’ennéagramme est un système à 27 positions archétypales, qui sont les schémas réactionnels de base du modèle. Une personne qui découvre et approfondit l’outil, peut ainsi identifier les schémas dans lesquels elle se retrouve le plus spontanément, selon les situations.
Validation scientifique de l’ennéagramme
L’existence de 9 profils indépendants, correspondant au modèle de l’ennéagramme, a pu être validée scientifiquement. Cela a été permis dans les années 2000’s par le test HPEI (Halin-Prémont Enneagram Indicator), et une exploitation statistique rigoureuse de ses résultats, suivant les règles de la psychométrie.
À défaut de valider l’entièreté du modèle, cela en valide déjà le fondement-même, c’est à dire le postulat de base des 9 profils, et leurs principales caractéristiques.
En fait, valider un modèle comme l’ennéagramme est délicat, parce qu’il observe les motivations sous-jacentes aux comportements, et non les comportements eux-mêmes. En cela, il est plus proche de la psychanalyse que de la plupart des typologies de personnalité modernes, qui sont essentiellement comportementales.
Or la psychanalyse n’est validée scientifiquement que parce que de nombreux praticiens valident empiriquement un ensemble de constats et de résultats, issus de leur pratique. Ce sont la mise en commun, l’essor de nouvelles idées et leur confrontation à la réalité humaine, l’éthique professionnelle et la qualité de l’enseignement, qui font la qualité scientifique de la discipline.
Il ne peut en être autrement avec l’ennéagramme, même si celui-ci n’est pas un outil thérapeutique, et fait appel à des compétences différentes. Dans les 2 cas on est dans la pâte humaine, avec toute sa subjectivité, et la prédominance du rapport interpersonnel dans la relation d’accompagnement.
Limites et bienfaits du rationalisme scientifique
Certains considèrent qu’une chose n’existe que si elle peut être expliquée de façon rationnelle. Ceux-la attendent en général de l’ennéagramme qu’il soit intégralement modélisé, et que le modèle soit à la fois vérifiable et prédictif.
Mais peut-on vraiment souhaiter que de tels outils, très finement modélisés, soient avalés par une intelligence artificielle, et utilisés à des fins commerciales ou de pouvoir ?
Poussé à l’extrême, le rationalisme scientifique peut donc être aveugle, et même dangereux.
Pratiqué avec discernement par contre, il est indispensable pour faire progresser les approches. Et c’est justement cet esprit scientifique ouvert qui a permis de faire évoluer l’ennéagramme sur les dernières décennies, et de le faire reconnaître comme un modèle robuste et pertinent.
Une question d’approche, plus que de modèle
On ne comprend pas l’ennéagramme tant qu’on le voit comme un outil qui « classe » les gens selon leur profil de personnalité – ou bien comme un outil qui modéliserait la personnalité de façon exclusive, ou meilleure que d’autres.
L’ennéagramme est un outil ouvert, qui propose, sans les imposer, des explications à nos réactions intérieures spontanées, et des chemins d’évolution vers plus de sérénité. Quand le voit ainsi, on comprend alors que l’important est la façon d’utiliser le modèle, bien plus que le modèle lui-même.
Avoir une approche scientifique de l’ennéagramme, c’est voir les limites de l’outil, et discerner quand un autre devient plus pertinent. C’est savoir accueillir l’expérience brute vécue telle qu’elle est partagée, sans chercher à la modéliser. C’est aussi remettre en cause en permanence ce que l’on croit savoir sur le modèle, pour enrichir la compréhension qu’on en a, et développer sa capacité à l’utiliser à bon escient.
Pour quiconque souhaite proposer avec éthique un outil comme l’ennéagramme, c’est un long parcours, exigeant, qui demande de connaître d’autres outils concurrents ou complémentaires. L’ennéagramme supporte très bien la contradiction, et plus on le challenge, mieux on l’utilise. Plus on est conscient de ses limites, mieux on en perçoit la portée, et l’étonnante justesse !
© Sébastien GIRARD – 09/2024 – écrit sans IA